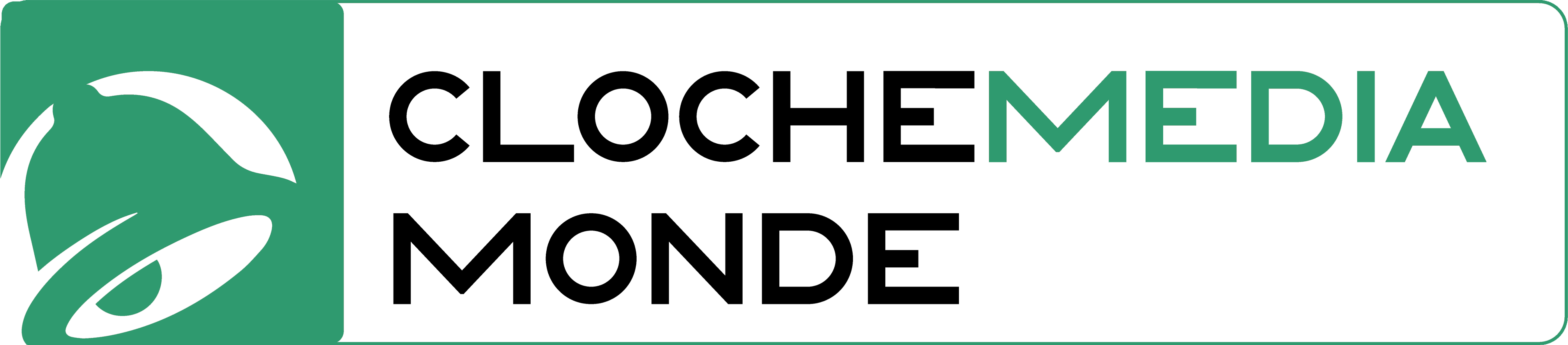Les cris d’alerte viennent de partout. Patients agonisants, citoyens compatissants, etc, des voix s’élèvent pour réclamer un regard attentif des pouvoirs publics envers les personnes en situation de dialysée. Entre souffrance silencieuse, coûts prohibitifs et inégalités criantes, l’Afrique de l’Ouest peine à offrir une réponse sanitaire équitable à des milliers de malades rénaux. Focus sur la situation au Bénin et dans la sous-région, où la gratuité des soins reste un idéal encore lointain.
Une pathologie silencieuse et meurtrière
L’insuffisance rénale chronique (IRC) s’impose comme une menace grandissante de santé publique dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Maladie insidieuse, longtemps asymptomatique, elle évolue progressivement vers la défaillance irréversible des reins. Sans traitement de suppléance — hémodialyse ou greffe —, elle mène inéluctablement à la mort.
L’augmentation des cas est corrélée à la montée des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle, l’automédication abusive, le recours incontrôlé aux plantes médicinales, la pollution, le manque d’eau potable, et l’insuffisance de dépistage précoce. En Afrique de l’Ouest, jusqu’à 10 % de la population adulte pourrait souffrir d’une atteinte rénale sans le savoir, selon la Société africaine de néphrologie. Au Bénin, l’IRC se positionne comme la troisième cause de morbidité après les maladies infectieuses et la malnutrition. Pourtant, la prise en charge reste limitée, coûteuse et inégalitaire.
Le Bénin : du progrès à la régression silencieuse
Pendant des années, le Bénin a été cité en exemple pour sa politique de prise en charge gratuite à 100 % des soins des insuffisants rénaux, une décision initiée dès 1999 par le général Mathieu Kérékou. L’État couvrait les frais de dialyse, de consultation et de traitement au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, puis dans les centres publics de régions.
Cette politique de solidarité sanitaire s’est poursuivie sous le Président Boni Yayi, permettant à des centaines de malades — y compris non-fonctionnaires — de survivre grâce à la dialyse. Toutefois, depuis janvier 2019, un tournant drastique s’est opéré : la délivrance de certificats de prise en charge aux nouveaux patients a été suspendue. Seuls les fonctionnaires et anciens bénéficiaires continuent d’être couverts.
Face aux critiques, l’exonération de certains produits médicaux a été annoncée par les autorités, mais l’impact reste faible pour les malades qui doivent toujours affronter des coûts dépassant 9 millions FCFA par an, dans un pays où le SMIG plafonne à 52 500 FCFA.
Un traitement inabordable pour la majorité
Une évaluation sommaire des coûts révèle une réalité effrayante : consultation néphrologique : entre 7 000 FCFA (CNHU) et 15 000 FCFA (centres privés) ; séances de dialyse : 85 000 FCFA minimum par séance. À raison de deux séances hebdomadaires, un malade doit débourser 680 000 FCFA par mois, soit 8 160 000 FCFA par an ; médicaments et examens : environ 960 000 FCFA par an ; greffe rénale : non pratiquée localement, nécessite un transfert onéreux à l’étranger.
Ainsi, plus de 9 millions FCFA sont nécessaires chaque année pour la survie d’un patient dialysé non pris en charge. Une somme inabordable pour l’écrasante majorité de la population.
Centres de dialyse : une couverture inégale
Le Bénin compte huit centres de dialyse, dont quatre publics (CNHU-HKM, CHD Borgou/Alibori, CHD Zou/Collines, CHD Ouémé/Plateau) et quatre privés. Cependant, leur répartition géographique reste inégalitaire et l’accès demeure difficile hors des grandes agglomérations.
Le pays ne dispose que de dix néphrologues, dont deux pour les enfants, pour une population de plus de 12 millions d’habitants. Une pénurie chronique qui freine la qualité et l’efficacité de la prise en charge.
Des milliers de décès silencieux
L’absence de politique claire, combinée à la suspension de la gratuité, a entraîné une véritable hécatombe. Depuis 2019, on estime à plus de 1 250 le nombre de décès dus à l’insuffisance rénale chronique au Bénin, en raison d’un défaut de prise en charge. Un chiffre probablement sous-estimé, les données officielles étant difficilement accessibles.
Une mosaïque de politiques dans la sous-région
À l’échelle régionale, les politiques de prise en charge varient fortement : Sénégal : gratuité dans les centres publics pour les citoyens avec carte nationale d’identité. Dialyse privée coûte entre 60 000 et 100 000 FCFA. Burkina Faso : gratuité dans les CHU de Ouagadougou et Bobo, mais nombre de places limité et fistule à la charge du patient. Côte d’Ivoire : prise en charge partielle, cas sociaux aidés, greffe rare. Togo : coût réduit à 35 000 FCFA dans le public pour les indigents ; greffe indisponible. Ghana : couverture partielle par assurance-maladie nationale. Greffe possible en partenariat. Nigeria : soins coûteux mais légèrement plus abordables dans le privé en raison du change. Mali : subvention faible, greffe inexistante. Partout, les mêmes défis reviennent : coût élevé, offre de soins limitée, manque de personnel formé, inégalités d’accès.
Des initiatives de solidarité à saluer
Quelques associations, ONG et bienfaiteurs œuvrent à soulager les souffrances. L’ONG OREDOLA BENIN E.V., fondée par le Dr José Koussemou, a permis la pose gratuite de fistules par des spécialistes allemands au CNHU-HKM et a formé du personnel local. D’autres associations de dialysés ou de solidarité agissent également sur le terrain pour fournir matériel, médicaments et assistance aux plus démunis.
Face à cette urgence sanitaire croissante, plusieurs pistes doivent être envisagées pour inverser la tendance : rétablir la gratuité intégrale des soins de dialyse ; renforcer les programmes de formation en néphrologie ; décentraliser l’offre de soins en créant des centres dans toutes les régions ; créer une unité nationale de fourniture de kits de dialyse au sein des centrales d’achat de médicaments ; mettre en place un programme régional de greffe rénale ; intensifier les campagnes de dépistage précoce ; mettre en œuvre une politique de prévention contre les maladies rénales ; étendre la couverture maladie universelle à toutes les couches sociales.
Un impératif de justice sanitaire
L’insuffisance rénale chronique constitue aujourd’hui une bombe sanitaire à retardement en Afrique de l’Ouest. Le traitement, bien que techniquement possible, reste hors de portée pour des milliers de malades en raison de l’absence de volonté politique soutenue. Il est temps que les États, à commencer par le Bénin, prennent des mesures concrètes, courageuses et inclusives pour sauver des vies. La santé, faut-il le rappeler, est un droit fondamental.
Boris MAHOUTO