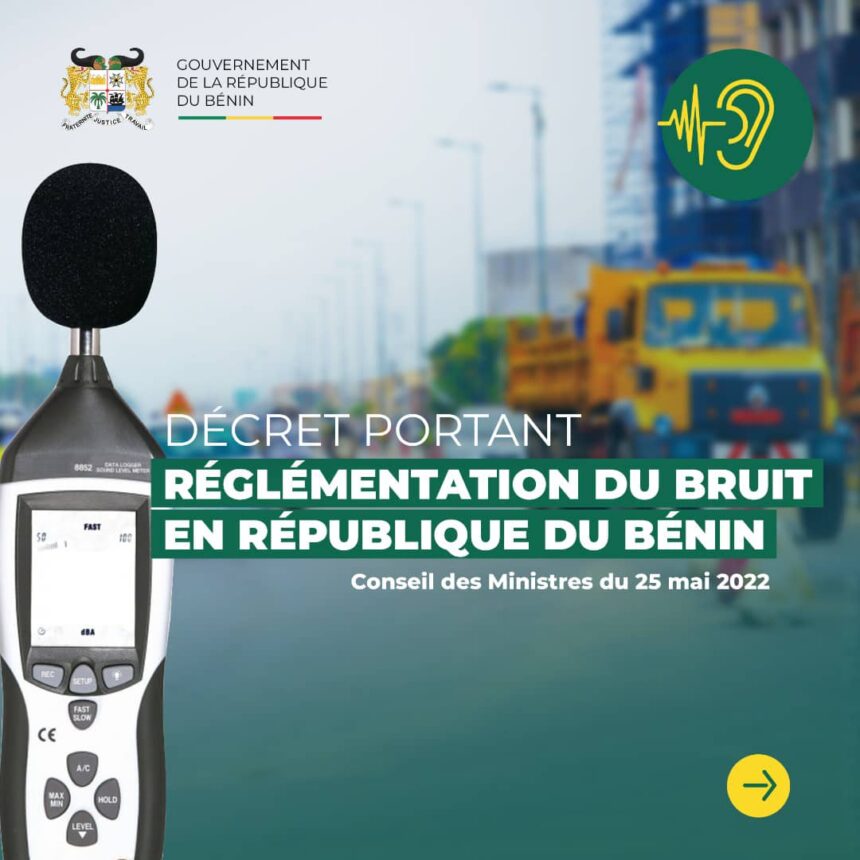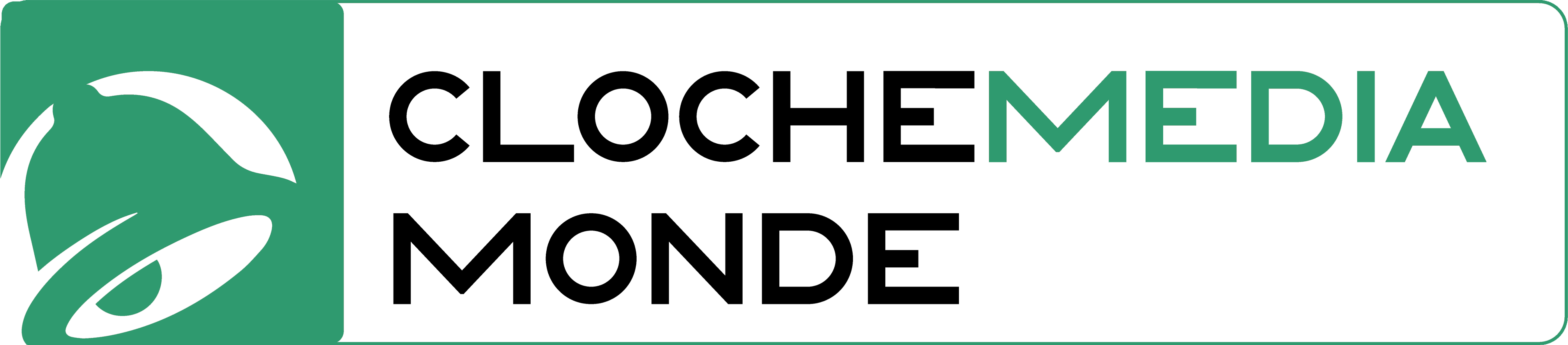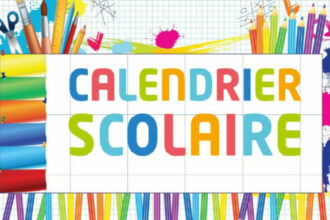Les klaxons stridents des taxis-motos, les haut-parleurs des églises évangéliques, les bars en plein air qui s’improvisent boîtes de nuit, les prêches matinaux amplifiés depuis des minarets ou des chapelles, les vendeurs ambulants criant leurs marchandises dès l’aube… Bienvenue au Bénin, où le vacarme ambiant compose la bande-son quotidienne de millions de citoyens. Un tumulte sonore devenu banal, voire culturel, mais aux effets pernicieux, dans un pays pourtant doté de textes réglementant la nuisance sonore. Des textes, hélas, qui peinent à trouver écho dans la réalité.
La pollution sonore est bel et bien reconnue par le droit béninois. Le Décret n°2001-109 du 4 avril 2001 fixe les normes de bruit admissibles et interdit les émissions sonores excessives, notamment de 22 h à 6 h. Il est complété par d’autres textes comme le Code de l’Environnement ou les arrêtés municipaux. Mais ces lois restent lettres mortes dans la plupart des cas. Le problème n’est pas tant l’absence de cadre juridique que le manque d’application et de volonté politique. Une législation en panne d’application qui inquiète et incite à la méditation. « Nous avons les textes, mais les moyens de contrôle sont quasiment inexistants. Il n’y a pas assez d’agents assermentés, et même lorsqu’une plainte est déposée, elle est rarement suivie d’effet », déplore un cadre du ministère du Cadre de Vie, sous couvert d’anonymat.
*Le vacarme des lieux de culte et des bars*
Les églises évangéliques pullulent dans les quartiers populaires, souvent installées dans des maisons louées sans isolation phonique. Le week-end, les nuits deviennent insupportables dans certains arrondissements de Cotonou, Porto-Novo ou Parakou. Les cris extatiques des fidèles et les instruments amplifiés transpercent les murs, au mépris du voisinage. Les bars et maquis ne sont pas en reste : les soirées dansantes débordent souvent jusque tard dans la nuit, sans que les autorités locales n’interviennent, parfois par complicité, parfois par crainte de réactions violentes.
*Victimes silencieuses, citoyens résignés*
Les premières victimes de cette cacophonie sont les citoyens ordinaires : élèves, étudiants, malades, travailleurs de nuit ou personnes âgées. Beaucoup se plaignent, peu osent aller plus loin. « On sait que même si on appelle la police, personne ne viendra. Ou alors, le pasteur ou le tenancier du bar va corrompre les agents », témoigne Rosine, une infirmière vivant à Abomey-Calavi.
*Des conséquences graves sur la santé*
La pollution sonore n’est pas qu’un désagrément ; elle est un facteur reconnu de stress, de troubles du sommeil, de baisse de concentration et même de maladies cardiovasculaires. L’OMS recommande un niveau de bruit ambiant ne dépassant pas 55 décibels la journée et 40 la nuit. À Cotonou, certaines zones dépassent régulièrement les 80 décibels en soirée. Pourtant, très peu d’études locales permettent de mesurer scientifiquement l’ampleur du phénomène, faute de moyens.
*Responsabilités partagées*
Le problème est systémique. Les autorités locales ferment souvent les yeux. La population banalise. Et les institutions étatiques manquent cruellement de moyens, d’équipements de mesure, de formation et d’indépendance. Le politique, quant à lui, rechigne à contrarier certains groupes religieux ou économiques, par calcul électoraliste.
*Des pistes pour en sortir ?*
Pour inverser la tendance, plusieurs mesures pourraient être envisagées : former et équiper des brigades spécialisées dans le contrôle du bruit ; sanctionner réellement les contrevenants, quels qu’ils soient ; réviser et vulgariser la législation existante en matière de pollution sonore ; sensibiliser la population, notamment dans les écoles, sur les effets du bruit ; encourager les constructions à isolation acoustique, en milieu urbain surtout.
*Un enjeu de santé publique et de gouvernance*
La pollution sonore est l’un des angles morts des politiques publiques au Bénin. Et pourtant, elle dit beaucoup de notre rapport à l’espace public, au vivre-ensemble et à la gouvernance. Elle révèle une société bruyante non seulement en décibels, mais aussi en indiscipline, en impunité et en résignation. Tant que les lois feront davantage peur sur le papier que dans la rue, le silence restera un luxe. Et la santé des citoyens, une variable d’ajustement.
Pollution sonore au Bénin : Des lois muettes ?