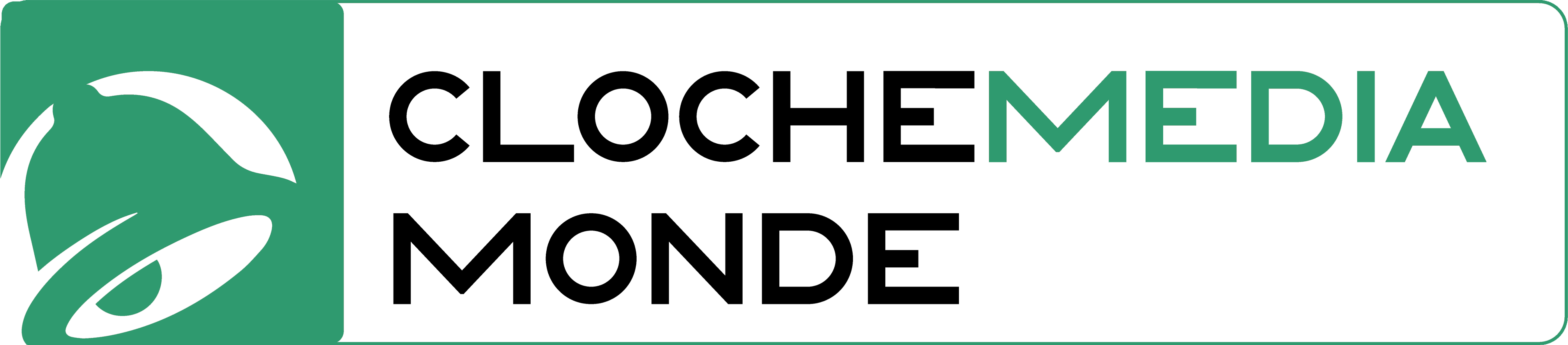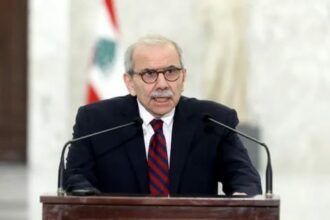Près de 80 chefs d’État et de gouvernement se retrouvent ce lundi 24 novembre à Luanda pour le 7ᵉ sommet UA–UE. Pendant deux jours, la capitale angolaise devient le théâtre d’un dialogue décisif entre les deux continents, autour du thème : « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Derrière les discours, un enjeu majeur : redéfinir une relation qui s’essouffle et cherche un nouvel équilibre.
L’agenda est dense pour les dirigeants africains et européens réunis dans la capitale angolaise. Deux sessions thématiques rythment les travaux : Paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme; Citoyenneté, migrations et mobilité. Les crises se multiplient sur les deux rives : guerre en Ukraine, instabilité au Sahel, conflit dans l’Est de la RDC, guerre au Soudan… Autant de dossiers qui exigent un dialogue franc entre l’Union africaine et l’Union européenne.
Ce sommet, troisième du genre organisé en Afrique après Le Caire (2000) et Abidjan (2017), marque 25 ans de coopération politiques, économiques et stratégiques. « Un partenariat robuste, équilibré et tourné vers l’avenir », promet Antonio Costa, président du Conseil européen. Mais derrière l’optimisme affiché, les interrogations persistent.
Une relation à repenser : la fin du réflexe paternaliste ?
La question du futur partenariat domine les discussions. « La relation doit être revisitée », insiste Pascal Saint-Amans, professeur à l’Université de Lausanne. Pour lui, le temps d’un rapport déséquilibré appartient au passé : « Les échanges économiques ont longtemps relevé d’une logique post-coloniale. Aujourd’hui, le basculement géopolitique mondial crée une opportunité pour un partenariat d’égal à égal, moins paternaliste, plus stratégique. »

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Global Gateway, programme phare lancé en 2021 par l’UE. Ce plan prévoit 300 milliards d’euros d’investissements d’ici 2027, dont 150 milliards pour l’Afrique, destinés aux infrastructures, aux énergies vertes, au numérique et aux transports. Le business forum prévu en ouverture du sommet doit en préciser les contours.
Mais au sein même de la délégation européenne, la prudence domine. Un membre confie : « Il ne faut pas tomber dans l’obsession du business. L’Union européenne ne peut sacrifier ses valeurs. Si nous ne défendons plus la gouvernance et les droits humains, que resterait-il de notre identité ? » Sous-entendu : l’Europe veut continuer à se distinguer de la Chine ou de la Russie, dont l’approche priorise les intérêts économiques ou militaires.
L’Europe, premier acteur humanitaire en Afrique : un rôle à clarifier
Au cœur des débats, un autre enjeu : le rôle humanitaire de l’Union européenne sur un continent confronté à des crises récurrentes. Dans certains pays comme la RDC, l’UE est devenue le premier bailleur, en partie parce que les États-Unis ont réduit leur aide.
Cette montée en puissance impose une réflexion stratégique : Comment éviter que l’aide humanitaire ne supplante les investissements durables ? Comment répondre à l’urgence sans créer de dépendance ? Comment articuler action humanitaire et diplomatie géopolitique ?
Des voix africaines s’interrogent déjà sur un glissement de la politique européenne : « On sent que l’UE met davantage l’accent sur l’économie et la sécurité, au détriment des droits de l’homme et de la démocratie. Quand on interpelle Bruxelles, la réponse est souvent : “Nous ne nous immisçons pas dans les affaires intérieures, nous aidons sur le plan économique et humanitaire.” Ce n’est pas la relation que nous souhaitons. »
Luanda, scène d’un moment décisif
Alors que les chefs d’État se retrouvent ce 24 novembre, les attentes sont immenses. Pour l’Afrique, il s’agit de bâtir un partenariat moins asymétrique, capable d’accompagner les transitions économiques, sécuritaires et sociétales du continent. Pour l’Europe, c’est l’occasion de réaffirmer son influence, dans un contexte de compétition mondiale exacerbée.
Un quart de siècle après le premier sommet, Luanda pourrait devenir le point de départ d’un nouveau chapitre entre les deux continents : un partenariat repensé, assumé, et véritablement mutuellement bénéfique.
CMM