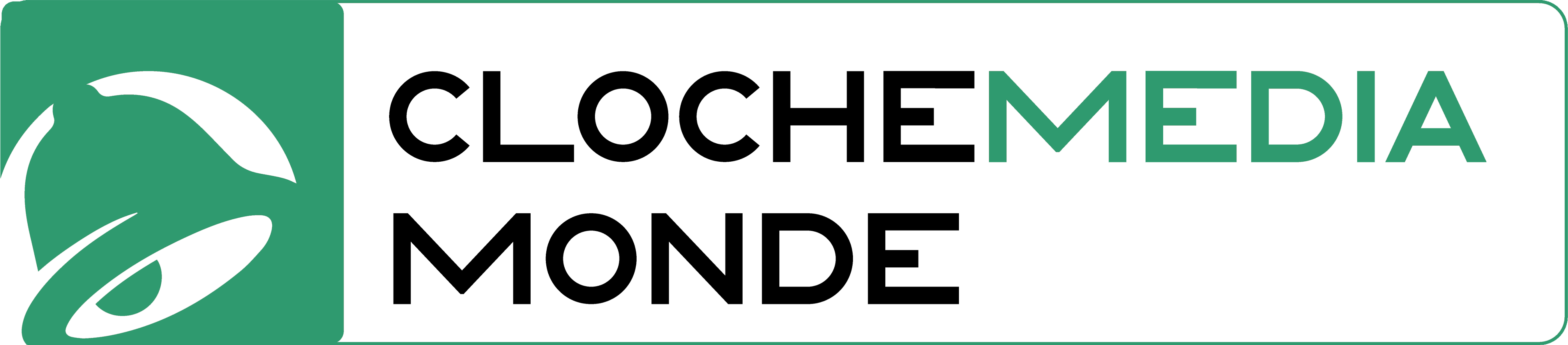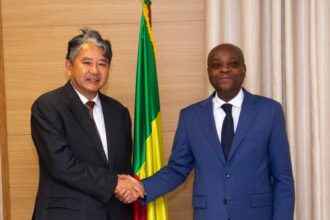Le Bénin affiche depuis quelques années des progrès significatifs en matière de bancarisation. Avec plus de 50 % de la population disposant désormais d’un compte bancaire ou d’un portefeuille mobile, selon les données de la BCEAO, le pays figure parmi les bons élèves de l’UEMOA en matière d’inclusion financière. Mais derrière cette avancée technologique et institutionnelle se cache une réalité plus amère : la pauvreté continue de ronger les fondations sociales. Une contradiction qui interroge.

Portée par l’explosion du mobile money, la politique de digitalisation des services financiers et les efforts conjugués des banques et des microfinances, la bancarisation connaît un essor sans précédent au Bénin. Le gouvernement a misé sur une stratégie de modernisation des paiements : salaires, aides sociales, taxes et frais administratifs passent de plus en plus par des canaux électroniques. Les zones rurales sont progressivement connectées aux services bancaires via les agences mobiles et les services USSD. Une bancarisation en forte croissance qui logiquement devrait induire un impact positif sur le quotidien des populations. Mais hélas ! « Il y a dix ans, moins de 20 % des Béninois avaient un compte bancaire. Aujourd’hui, on est au-dessus de la moitié, et ce taux grimpe encore grâce aux portefeuilles mobiles », se réjouit un responsable du ministère des Finances.

Un paradoxe économique inquiétant
Mais cet indicateur positif ne semble pas se refléter dans le quotidien des Béninois. Le taux de pauvreté, mesuré par l’INSAE, a connu une remontée inquiétante ces dernières années, flirtant avec les 40 %. Dans les marchés de Cotonou, de Parakou ou de Natitingou, vendeurs et clients racontent la même chose : le coût de la vie grimpe, les revenus stagnent, et l’accès à l’argent ne signifie pas nécessairement sortie de la pauvreté. « J’ai un compte mobile, oui, mais l’argent que je reçois ne couvre même pas les dépenses du mois », confie Pauline, une vendeuse de légumes à Bohicon. « La banque, c’est bien, mais ça ne remplit pas la marmite », se désole B. Aline, enseignante.
*Inclusion financière ne rime pas (encore) avec inclusion économique*
Le paradoxe est là : avoir un compte ne veut pas dire avoir de quoi le garnir. Beaucoup d’utilisateurs se contentent d’utiliser leur portefeuille mobile comme simple outil de transfert ou de réception de fonds. Les crédits bancaires restent hors de portée pour la majorité, en raison des garanties exigées et du niveau d’endettement. « On parle de bancarisation, mais sans éducation financière, sans hausse des revenus, sans emploi stable, cette bancarisation reste une façade », explique Dr. Adjaï Amoussou, économiste à l’Université d’Abomey-Calavi.
*Les limites d’un modèle orienté vers les chiffres*
Derrière l’enthousiasme des institutions financières se cache une tendance à prioriser la quantité sur la qualité. Avoir une grande base de clients numériques ne signifie pas que ces derniers profitent réellement des services. Beaucoup sont inactifs ou utilisent les services de manière sporadique. Et les inégalités persistent : les femmes, les jeunes ruraux et les personnes sans éducation formelle sont les plus exclus des services financiers évolués.
*Vers une vraie inclusion ?*
Pour que la bancarisation rime avec réduction de la pauvreté, plusieurs leviers doivent être actionnés. Il faut renforcer les filets sociaux, promouvoir l’entrepreneuriat, adapter les services financiers aux réalités locales, et surtout, favoriser l’emploi. Car l’argent ne circule que là où il y a création de valeur.
La digitalisation financière est un outil, pas une fin en soi. Tant que les populations ne verront pas d’impact direct sur leur pouvoir d’achat, la bancarisation risque de rester une promesse creuse. Le Bénin a franchi une étape. Il lui reste à transformer cette avancée technologique en progrès social.
Boris MAHOUTO