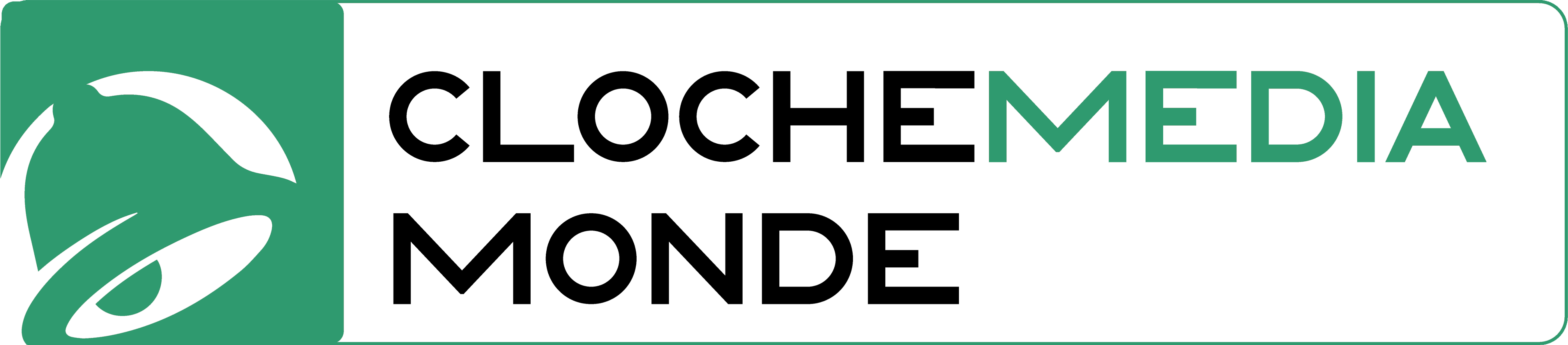Dans un monde en perpétuelle mutation où les repères démocratiques sont régulièrement mis à l’épreuve, la nécessité de repenser le socle de la gouvernance s’impose avec acuité. La République, les institutions et la citoyenneté ne sont pas de simples concepts abstraits ; ils constituent les piliers essentiels d’une démocratie vivante, équitable et juste. Ce triptyque forme le ciment de toute société aspirant à la stabilité, à la cohésion et au progrès.
*La République : un idéal d’unité et d’intérêt général*
La République est bien plus qu’un régime politique. Elle est la projection d’un idéal fondé sur l’égalité des citoyens devant la loi, la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers, et le refus de toute forme de domination arbitraire. Elle repose sur une organisation du pouvoir fondée sur la séparation des fonctions, la souveraineté populaire et la transparence.
Dans une République véritable, les symboles (drapeau, devise, institutions) ne sont pas de simples ornements. Ils incarnent des valeurs communes, celles de la solidarité, de la laïcité, du vivre-ensemble, et du respect des différences dans l’unité.
*Des institutions solides pour une gouvernance crédible*
Les institutions démocratiques – parlement, justice, exécutif, cour des comptes, institutions indépendantes – sont les garants de la régulation du pouvoir. Leur rôle est de limiter les abus, d’assurer la continuité de l’État, et de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Une démocratie sans institutions fortes est une démocratie vacillante, livrée aux dérives autoritaires, au clientélisme ou à la corruption.
Or, la solidité des institutions ne se mesure pas seulement à leur existence formelle, mais à leur capacité à fonctionner de manière indépendante, impartiale et au service de la population. Il ne suffit pas de créer des structures : encore faut-il les doter de moyens, leur garantir l’autonomie et faire respecter leurs décisions.
*La citoyenneté : levier d’une démocratie participative*
La citoyenneté, quant à elle, ne se réduit pas à l’acte de voter tous les cinq ans. Elle est une posture active, un engagement quotidien. Être citoyen, c’est comprendre ses droits mais aussi assumer ses devoirs. C’est participer aux débats publics, veiller à la reddition de comptes, défendre les libertés collectives, et promouvoir la justice sociale.
Une démocratie est d’autant plus vivante que les citoyens sont éduqués, informés et impliqués. L’éducation civique, le journalisme libre, l’accès à l’information et la culture du débat contradictoire sont donc des outils fondamentaux de la citoyenneté. Sans citoyens conscients et responsables, même les institutions les plus vertueuses peuvent être dévoyées.
*Équité et justice : finalités ultimes de la démocratie*
Une démocratie véritable ne peut s’accommoder de l’exclusion, de l’injustice sociale ou de la marginalisation de certains groupes. Elle doit viser l’équité, c’est-à-dire la capacité à traiter chacun selon sa situation, en réduisant les inégalités structurelles. La justice sociale n’est pas un luxe, mais une condition de la paix durable.
C’est à l’aune de l’équité que se mesure la qualité d’une démocratie. Une république qui ne protège que les puissants, des institutions qui ne servent que les élites, une citoyenneté réduite au silence : tout cela aboutit inévitablement à la défiance, à la colère populaire, voire à l’instabilité.
Le triptyque République – Institutions – Citoyenneté est plus que jamais d’actualité dans un contexte mondial marqué par les crises de confiance, la montée des populismes, les replis identitaires. Construire une démocratie fondée sur l’équité et la justice suppose de réhabiliter ces piliers, de les consolider, et d’en faire le moteur d’un contrat social renouvelé.
Ce n’est qu’au prix d’un dialogue constant entre gouvernants et gouvernés, d’une éducation politique de qualité et d’un engagement collectif que les sociétés pourront relever les défis du XXIe siècle sans trahir les promesses démocratiques de liberté, d’égalité et de fraternité.
Boris MAHOUTO