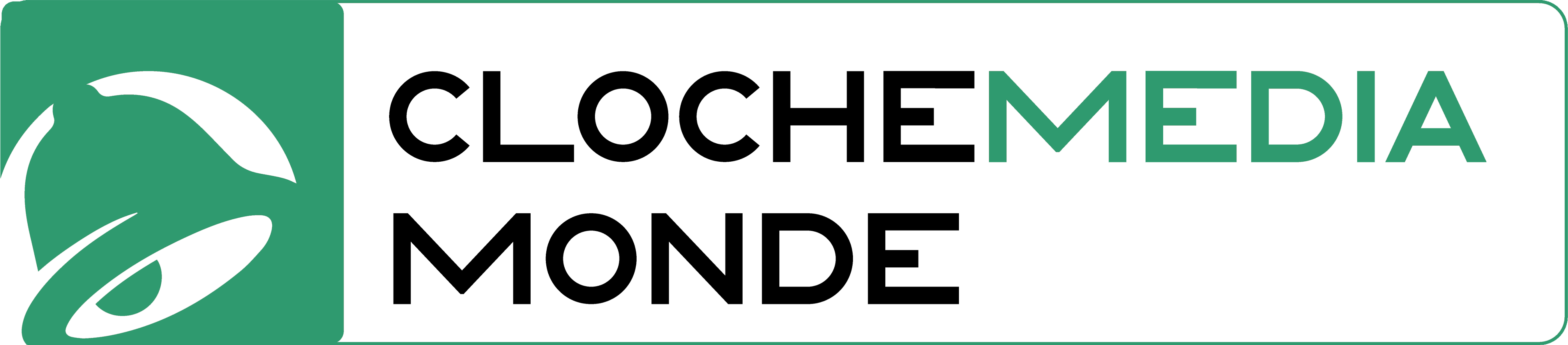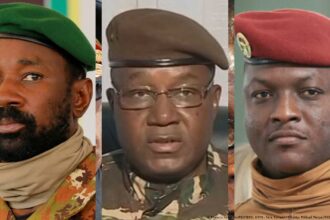C’est une rencontre militaire stratégique qui s’est tenue au Mali, marquée par la clôture des travaux des chefs d’États-majors généraux des armées de l’air des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), désormais Confédération des Etats du Sahel. Une réunion cruciale dans un contexte tendu, suite à un grave incident survenu à la frontière algéro-malienne, où l’armée algérienne a abattu un drone malien engagé dans une opération de surveillance contre des groupes armés terroristes en mouvement.*
Ce fait, largement interprété comme un affront diplomatique, a ravivé les tensions entre Alger et Bamako, jetant un voile d’incertitude sur la coopération sécuritaire régionale. L’incident a rapidement provoqué une onde de choc dans la sous-région, forçant les capitales sahéliennes à repenser leur coordination militaire, notamment dans le domaine aérien.
*Une crise symptomatique d’un Sahel fragmenté*
Pour Éric Ella, président du mouvement panafricaniste Vive l’Afrique Libre, cette crise n’est que le symptôme d’un mal plus profond : « Ce qui se passe au Sahel n’est pas une simple erreur de tir ou un malheureux accident diplomatique. C’est l’illustration d’une architecture sécuritaire africaine encore dépendante de vieilles logiques de méfiance et de cloisonnement hérité de la colonisation. »
Selon le penseur panafricaniste, l’incident met en évidence les fragilités des systèmes de défense nationaux, souvent isolés et peu interopérables. « L’armée malienne cherchait simplement à protéger son territoire contre des groupes armés transfrontaliers. Si l’Algérie considérait cela comme une menace, c’est qu’il n’y a pas encore une réelle vision commune de la sécurité régionale. »
*L’AES : un tournant stratégique dans la mutualisation de la défense*
C’est précisément pour répondre à ce type de défi que les chefs d’États-majors généraux des armées de l’air du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont retrouvés à Mopti. L’objectif de leur conclave est clair : mutualiser les moyens aériens, développer des capacités de surveillance conjointe dans l’espace sahélien et préparer des opérations coordonnées contre les groupes armés terroristes.
Le général Mamadou Sanogo, porte-parole du sommet, a insisté sur l’importance de la « rapidité d’action et de la puissance de feu dans un espace aussi vaste et instable que le Sahel ». Il a aussi annoncé la création d’un centre de coordination des opérations aériennes de l’AES, ainsi que le renforcement des mécanismes d’échange d’informations en temps réel.
*L’analyse d’Éric Ella : vers une souveraineté défensive africaine*
Pour Éric Ella, cette réunion pourrait marquer un tournant décisif si elle s’inscrit dans une dynamique d’intégration continentale. « C’est un pas dans la bonne direction. Les États du Sahel comprennent qu’ils doivent faire bloc. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, et cela passe par le contrôle aréien, la capacité de répondre rapidement à une menace, mais surtout la confiance entre pays frères. »
Il en appelle à une « diplomatie militaire panafricaine » qui favorise la collaboration plutôt que la suspicion. « Le drone malien n’était pas un acte hostile envers l’Algérie, mais un outil de protection d’un territoire commun à tous les peuples sahéliens. Il faut dépasser les frontières coloniales pour penser en termes de zones de sécurité partagée. »
*Une AES en quête de légitimité et de résultats*
Alors que la guerre contre le terrorisme s’enlise, que les ingérences extérieures persistent, et que les États de l’AES tentent de reprendre la main sur leur destin, cette réunion militaire semble poser les jalons d’une défense souveraine et intégrée. Mais pour le panafricaniste Éric Ella, l’enjeu dépasse le militaire : « C’est toute une vision du monde qu’il faut réinventer. L’Afrique doit cesser de sous-traiter sa sécurité. Tant que nos armées de l’air dépendent de satellites étrangers pour surveiller leurs propres territoires, nous ne pourrons pas parler de vraie indépendance. »
Entre diplomatie bousculée, impératif de souveraineté sécuritaire et nécessité d’une coopération militaire renouvelée, la crise algéro-malienne aura peut-être au moins un mérite : accélérer une prise de conscience. Dans ce Sahel troublé, l’unité n’est plus un luxe, mais une question de survie.
Crise diplomatique entre l’Algérie et le Mali : l’analyse du panafricaniste Éric Ella, en marge du conclave des armées de l’air de l’AES

Administrateur Général Adjoint de Cloche media monde