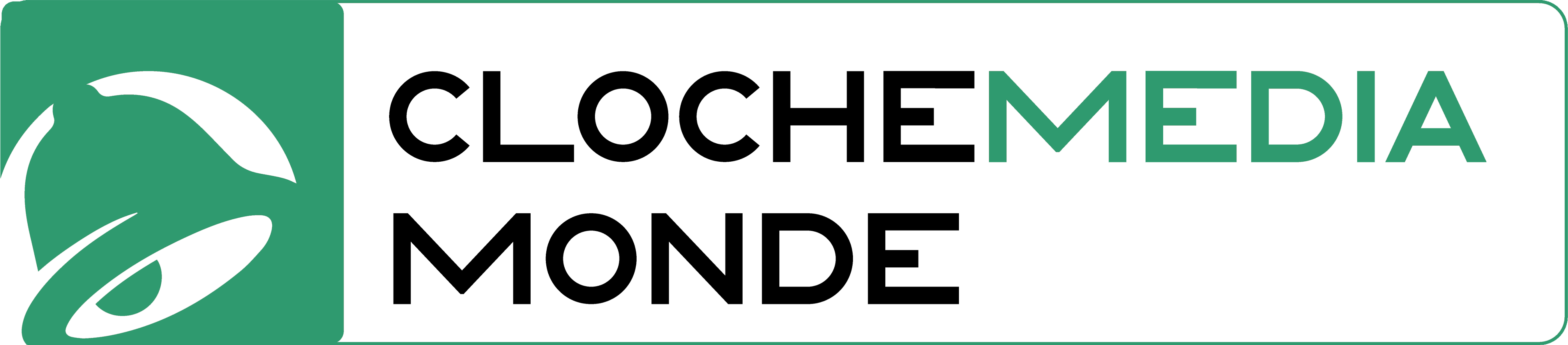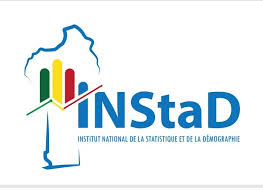Face à l’amenuisement inquiétant des flux financiers internationaux et à la raréfaction de l’aide publique au développement, les pays africains n’ont d’autre choix que de repenser leurs stratégies de financement. Les prévisions 2025 de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dressent un constat alarmant : les économies les plus vulnérables doivent s’affranchir de leur dépendance extérieure et accélérer la mobilisation de ressources internes pour soutenir leur trajectoire de développement.

Le rapport publié en mars 2025 par la Cnuced révèle une tendance préoccupante : les financements extérieurs à destination des pays en développement connaissent une contraction significative, au moment même où leurs besoins pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) atteignent des sommets. Deux signaux d’alerte dominent ce tableau : une baisse marquée de l’aide publique au développement (APD) et une volatilité accrue des investissements privés, dans un climat d’instabilité financière mondiale. Une conjoncture mondiale défavorable qui nécessite des actions urgentes.
Entre 2023 et 2025, les contributions des principaux bailleurs du Comité d’aide au développement ont chuté de près de 18 %, affectant de plein fouet les États les plus fragiles, en particulier en Afrique subsaharienne. Les secteurs essentiels – éducation, santé, infrastructures, lutte contre l’insécurité alimentaire – subissent les conséquences directes de cette diminution. Pire encore, l’APD allouée à la gestion de la dette s’est effondrée à 0,2 milliard de dollars en 2023, contre près de 6 milliards une décennie auparavant. Paradoxalement, les aides d’urgence humanitaire ont progressé à 31 milliards, alors que l’investissement dans les infrastructures économiques, socle de la résilience, stagne autour de 28 milliards. Ce déséquilibre met en lumière une réponse internationale plus réactive que proactive.

L’éveil des dynamiques endogènes
Conscients de cette nouvelle donne, plusieurs pays africains, loin de céder à la fatalité, amorcent une mutation stratégique en faveur des financements locaux. Le Bénin illustre cette dynamique de réorientation. Depuis 2022, le gouvernement y a renforcé la mobilisation de l’épargne intérieure à travers une politique proactive d’émission de bons et d’obligations du Trésor sur le marché financier régional de l’UEMOA. En 2024, près de 80 % du financement de son budget d’investissement provenait de ressources domestiques, témoignant d’un tournant significatif.
Parallèlement, le pays développe des instruments d’investissement accessibles aux ménages et aux PME, afin de canaliser l’épargne populaire vers des usages productifs. La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), longtemps sous-utilisée, devient un acteur central dans cette quête d’autonomie financière, réduisant graduellement la dépendance aux bailleurs internationaux.
*Des modèles inspirants ailleurs sur le continent*
D’autres États africains s’inscrivent dans cette même logique de souveraineté financière. Le Sénégal, par exemple, a institué des Fonds souverains d’investissement, financés par les recettes fiscales et des partenariats public-privé. Ces fonds visent à soutenir l’agriculture, l’industrialisation, les infrastructures et les énergies renouvelables. Le Rwanda, quant à lui, mise sur une stratégie d’inclusion financière via la bancarisation de masse et la microfinance. Sa politique fiscale progressive permet également d’augmenter les recettes domestiques sans accroître la pression sur les plus vulnérables.

Même au Nigeria, malgré un contexte marqué par une dette publique croissante, les autorités ont lancé avec succès des programmes d’obligations vertes, en partenariat avec le secteur privé national, pour financer la transition énergétique. Ces initiatives reflètent une volonté croissante de faire émerger des circuits de financement nationaux et innovants.
*L’incertitude des capitaux internationaux*
En parallèle, les flux financiers internationaux demeurent incertains. La perspective d’un renforcement du dollar américain, les hésitations sur la politique commerciale des États-Unis, ainsi que les tensions géopolitiques contribuent à une instabilité monétaire généralisée. En avril 2025, la fuite vers des actifs jugés plus sûrs a provoqué d’importantes sorties de capitaux de plusieurs marchés émergents.

La Chine a subi des désengagements massifs d’investisseurs non-résidents fin 2024, avant de connaître un léger redressement en début d’année. L’Inde et le Brésil, grâce à une stabilité macroéconomique renforcée, ont vu leur attractivité financière progresser. En revanche, les pays africains, notamment ceux classés comme économies « frontières », doivent affronter des conditions d’emprunt particulièrement onéreuses, avec des spreads obligataires dépassant parfois les 8 %, freinant ainsi leur accès aux marchés internationaux.
*Vers une autonomie financière responsable*
La Cnuced appelle aujourd’hui à une refonte structurelle de la coopération internationale. Elle insiste sur la nécessité de réorienter l’aide publique vers des projets durables, productifs et structurants, et de donner aux pays bénéficiaires une voix réelle dans la planification de l’aide. Mais en attendant une refonte de l’ordre mondial, c’est aux États eux-mêmes qu’il appartient de poser les fondations de leur résilience.
Les expériences du Bénin, du Sénégal, du Rwanda ou du Nigeria démontrent que l’ingéniosité financière, couplée à une volonté politique affirmée, permet de bâtir des alternatives crédibles. La diversification des sources de financement, l’essor de l’épargne domestique, le renforcement des marchés régionaux de capitaux, l’optimisation fiscale et la transparence budgétaire sont désormais les piliers d’un développement souverain.
La route vers l’autonomie financière est semée d’embûches, mais elle est aussi porteuse d’une promesse : celle d’un continent africain capable de prendre en main son destin, sans renoncer à l’ambition d’un développement inclusif, durable et équitable.
Boris MAHOUTO