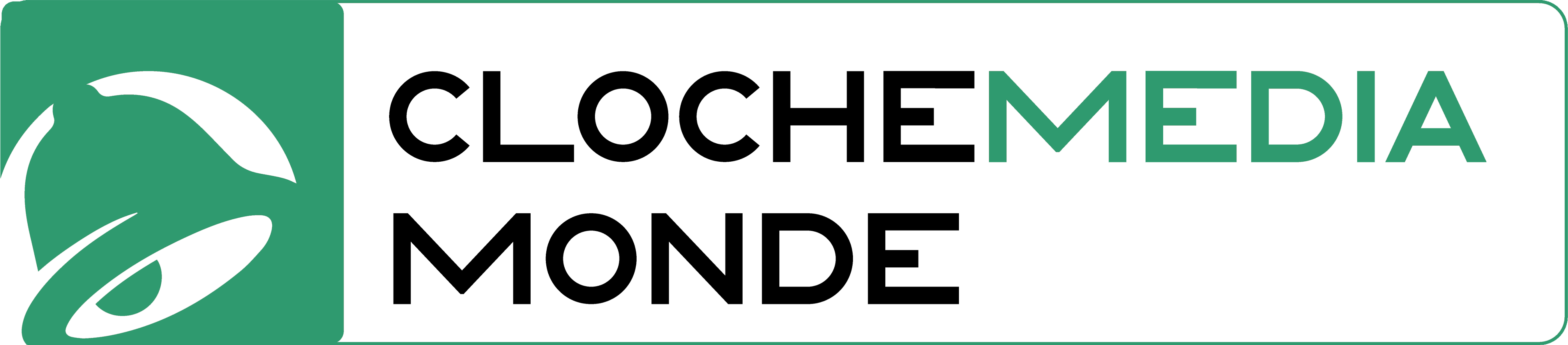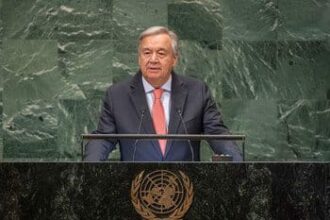Alors que le monde entier est plongé dans le recueillement à l’annonce du décès du Pape François, la Cité du Vatican, si discrète d’ordinaire, devient pour quelques jours l’épicentre d’une effervescence diplomatique mondiale sans précédent. Au-delà de l’émotion sincère provoquée par la disparition d’un pontife qui a marqué l’histoire contemporaine par son humilité, son progressisme et son engagement pour la paix, se dessine, derrière les dorures des basiliques et l’apparente solennité des cérémonies, une intense bataille d’influence aux ramifications planétaires.

La disparition d’un souverain pontife n’est jamais un simple événement religieux. L’Église catholique, forte de plus de 1,3 milliard de fidèles répartis sur tous les continents, est aussi un acteur géopolitique majeur. Le Pape François, premier pontife venu d’Amérique latine, avait redonné une voix forte au Sud global, plaidant pour les pauvres, les migrants et la sauvegarde de l’environnement. En s’éteignant, il laisse un vide non seulement spirituel, mais également diplomatique.

À Rome, chefs d’État, dignitaires religieux de toutes confessions, organisations internationales et grandes puissances déploient leurs délégations, officiellement pour rendre hommage, officieusement pour peser sur la succession. Car le choix du futur pape déterminera l’orientation politique du Vatican pour les décennies à venir.

Un conclave aux enjeux globaux
Dans l’intimité feutrée de la Chapelle Sixtine, les cardinaux électeurs, eux-mêmes choisis en majorité par François, devront désigner son successeur. Mais derrière les portes closes, les lignes de fracture sont déjà palpables.
Trois grandes tendances s’affrontent : Les conservateurs, majoritairement européens, souhaitent un retour à une Église plus dogmatique, recentrée sur la tradition et plus prudente sur les questions sociétales. Les réformateurs, proches de l’esprit de François, veulent poursuivre l’ouverture, l’inclusion et les réformes institutionnelles. Les mondialistes, notamment issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, réclament une Église plus décentrée de l’Europe, plus proche des réalités des « Églises du Sud », et plus active sur le terrain politique global.
Chaque camp bénéficie du soutien discret, mais bien réel, de différentes puissances étatiques qui voient dans le futur pape un partenaire — ou un obstacle — pour leurs ambitions : Washington, Pékin, Moscou, mais aussi des acteurs comme le Brésil, l’Inde ou des monarchies du Golfe surveillent de près les manœuvres en cours.

Le Vatican, un microcosme du monde
La diplomatie vaticane, l’une des plus anciennes et influentes du monde, pèsera de tout son poids dans l’orientation à venir. Le choix d’un pape sensible aux causes africaines, par exemple, pourrait changer la donne sur des dossiers aussi cruciaux que l’immigration, le changement climatique ou la lutte contre le terrorisme. Inversement, un pape conservateur d’Europe de l’Est pourrait repositionner l’Église dans une logique de confrontation idéologique avec des régimes autoritaires et des mouvements sociétaux progressistes.
*Un enjeu symbolique pour un monde en mutation*
Au-delà des tractations invisibles, l’élection d’un nouveau pape sera le miroir des tensions et des espoirs du XXIᵉ siècle : entre Nord et Sud, entre tradition et modernité, entre ouverture et repli.
Le successeur de François devra se positionner face à un monde secoué par la montée des nationalismes, les crises migratoires, les défis environnementaux et les fractures religieuses. Son action ou son inaction influencera autant les consciences que les grandes stratégies internationales.
*Une messe funèbre sous haute surveillance*
Tandis que les funérailles nationales se préparent, sous une sécurité digne d’un sommet du G20, le monde retient son souffle. Derrière les visages graves, derrière les accolades solennelles et les hommages appuyés, se joue déjà l’après-François : un nouveau chapitre de l’histoire du Vatican, mais aussi, peut-être, de l’équilibre géopolitique mondial. Car au Vatican, rien n’est jamais totalement spirituel. Ici, foi et pouvoir parlent une langue commune.
Boris MAHOUTO