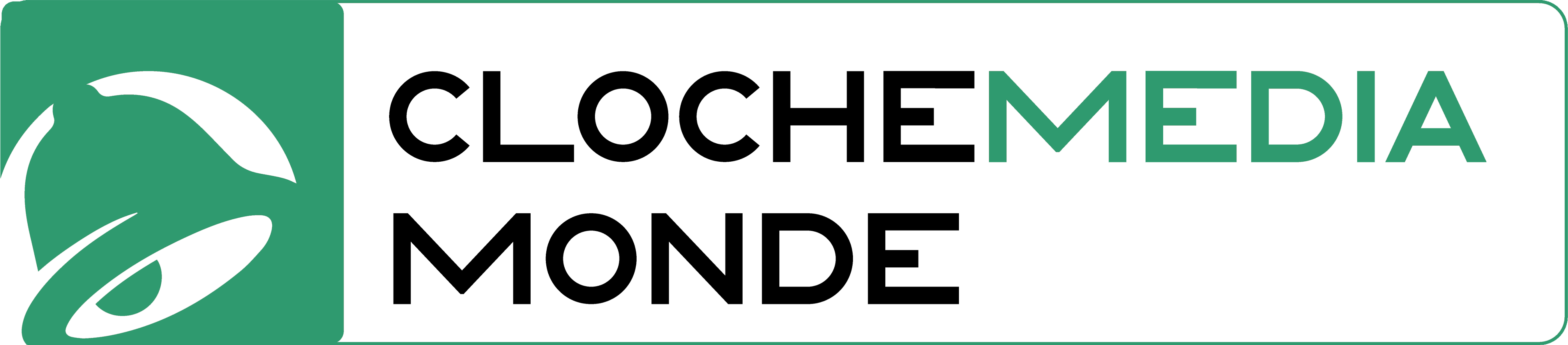La réforme du Code électoral béninois, imposant désormais un seuil de 20 % au plan national pour les élections présidentielles et législatives, et de 10 % pour les élections communales, suscite des interrogations. Entre limitation de la pluralité politique, régression du taux de participation, effritement des fiefs électoraux et bouleversement de la sociologie électorale, le débat est relancé sur l’avenir du jeu démocratique au Bénin.

Depuis l’adoption des nouvelles dispositions du Code électoral, les acteurs politiques, observateurs avertis et citoyens engagés expriment de vives inquiétudes. L’obligation pour les partis ou candidats d’obtenir 20 % des suffrages exprimés au plan national pour participer pleinement aux législatives ou prétendre à la présidentielle, et 10 % pour s’imposer au niveau local, semble verrouiller davantage l’espace politique déjà fragilisé. Ces seuils apparaissent comme un filtre sévère qui, sous couvert de rationalisation du système partisan, limite en réalité l’expression démocratique et rend quasiment impossible l’émergence de nouvelles forces politiques.
*Une pluralité en péril*
Le Bénin, autrefois considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l’Ouest, voit son paysage politique se réduire comme peau de chagrin. Les partis historiques, régionaux ou communautaires, autrefois bastions d’expression de la diversité sociologique du pays, peinent désormais à survivre à la rigueur des nouvelles normes électorales. Le pluralisme politique en sort affaibli.
En effet, ces seuils rendent l’entrée aux élections conditionnée par une puissance nationale difficilement atteignable pour les partis naissants ou pour ceux dont l’influence est plus régionale que nationale. Cela entérine une logique bipolaire et favorise les grandes formations politiques, au détriment de la diversité et de la représentativité.
*La régression du taux de participation : un symptôme préoccupant*

À ces contraintes s’ajoute un constat alarmant : la baisse continue du taux de participation. Lors des dernières élections, une partie non négligeable de la population a tourné le dos aux urnes, désabusée par un système jugé verrouillé et peu inclusif. Ce désengagement des électeurs traduit un malaise démocratique profond. L’instauration de seuils élevés pourrait renforcer ce désintérêt, en donnant le sentiment que les jeux sont faits d’avance et que le vote n’a plus de véritable impact.
*La disparition des “fiefs” : vers une uniformisation forcée*
Autre conséquence insidieuse : la mise à mal de la notion de “fief électoral”. Traditionnellement, le Bénin a été caractérisé par une cartographie politique où certains partis s’appuyaient sur des bastions régionaux, ethniques ou communautaires. Ces zones d’influence, bien qu’imparfaites, permettaient une représentation des réalités locales.
Avec les seuils nationaux imposés, ces fiefs perdent de leur valeur stratégique. Un parti fort dans une région, mais faible à l’échelle nationale, est désormais éliminé du jeu politique. C’est une forme d’uniformisation imposée qui ignore la réalité de la sociologie électorale béninoise.
*Un choc pour la sociologie électorale*
La réforme marque une rupture brutale avec la dynamique électorale fondée sur le multipartisme et la représentativité des divers courants sociologiques. Elle bouleverse les équilibres établis, et tend à remodeler artificiellement la scène politique selon une logique de rentabilité électorale nationale.
Cela pose la question de la cohérence entre les règles électorales et la réalité socioculturelle du Bénin. Peut-on exiger une assise nationale uniforme dans un pays aussi divers dans ses expressions politiques, identitaires et sociales ?
*Rationalisation ou exclusion ?*
En définitive, les taux de 20 % et 10 % imposés par le Code électoral peuvent être vus comme un outil de rationalisation du paysage politique, mais ils posent surtout le risque d’une démocratie amputée. L’exclusion de certaines voix, la dévalorisation des territoires, la baisse de la participation citoyenne et l’atteinte au pluralisme électoral sont autant d’éléments qui méritent une réflexion collective. La démocratie béninoise peut-elle se renforcer en écartant les plus faibles ? Faut-il sacrifier la représentativité sur l’autel de la stabilité ? Ces questions restent ouvertes, mais urgentes.