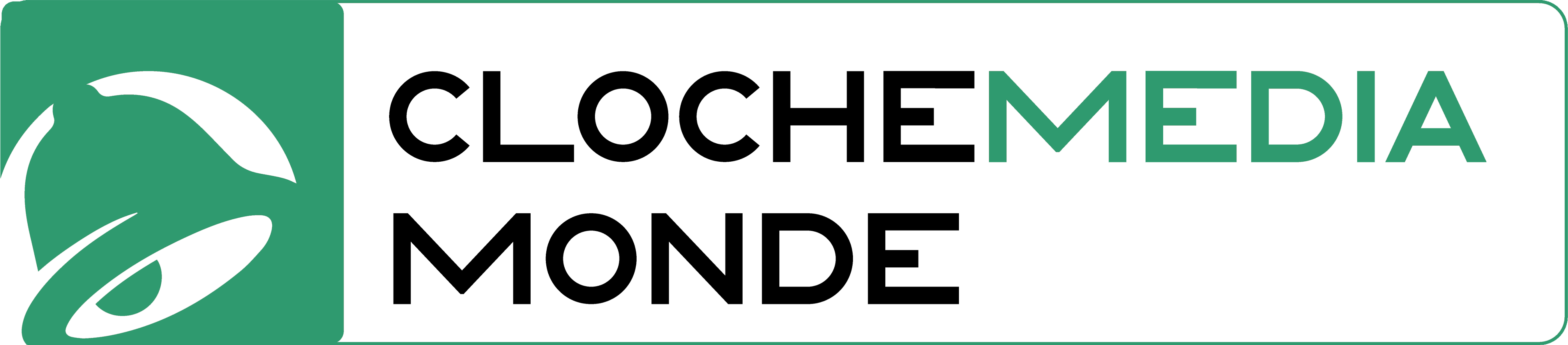En ce 3 mai 2025, le Bénin, à l’instar des autres pays du monde, célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Une date symbolique censée honorer le rôle essentiel des médias dans les sociétés démocratiques. Mais cette année, la célébration prend une teinte particulière, teintée d’inquiétude et de désenchantement. La publication, la veille, du classement mondial de la liberté de la presse par Reporters Sans Frontières (RSF) révèle une nouvelle dégradation de la situation au Bénin, qui perd cinq places par rapport à l’année précédente. Un signal d’alarme que l’on ne saurait ignorer.

Depuis l’avènement du régime dit de la Rupture en 2016, le paysage médiatique béninois n’a cessé de se transformer, mais pas toujours dans le sens d’un renforcement des libertés. La promesse d’assainir le secteur et de professionnaliser la presse a vite cédé le pas à une série de mesures restrictives : suspension de médias critiques, pressions judiciaires sur les journalistes, restrictions dans l’accès à certaines informations publiques, et une Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) souvent perçue comme un instrument de contrôle plutôt que de régulation indépendante.
Le recul de cinq places dans le classement de RSF n’est donc pas un accident isolé, mais le symptôme d’une tendance inquiétante. Derrière les discours officiels sur la liberté de la presse, les professionnels des médias, notamment ceux indépendants, font face à un climat d’autocensure grandissant, à la peur des représailles et à des conditions de travail de plus en plus précaires.

Un quatrième pouvoir affaibli
Le quatrième pouvoir, censé être le contre-pouvoir par excellence, se trouve aujourd’hui dans une posture ambiguë. Si quelques organes tentent encore de jouer leur rôle de sentinelle, beaucoup ont préféré se conformer, par nécessité économique ou par crainte politique. Les lignes éditoriales s’uniformisent, les débats contradictoires s’amenuisent, et l’espace public se rétrécit. Or, dans une démocratie en bonne santé, la presse ne doit pas être un relais docile du pouvoir, mais un acteur critique et libre, garant de la transparence, de la redevabilité et de la pluralité des opinions.
*Une veille d’élections sous tension*
Ce climat prend un relief particulier à la veille des élections générales prévues pour 2026, qui marqueront la fin du dernier mandat du président Patrice Talon. Dans un tel contexte, la presse devrait jouer un rôle crucial pour informer les citoyens, couvrir équitablement les différentes forces politiques et favoriser un débat électoral libre et éclairé. Mais comment espérer cela si la presse continue d’être muselée, voire marginalisée ?
L’enjeu est d’autant plus important que les prochaines élections détermineront l’orientation politique et institutionnelle du pays pour l’après-Talon. Une période sensible où la qualité de l’information et la liberté d’expression devraient être renforcées, non restreintes.
*Pour une presse libre, responsable et protégée*
La Journée mondiale de la liberté de la presse devrait être l’occasion d’un sursaut collectif. Les autorités doivent comprendre qu’une presse libre ne menace pas la stabilité, elle la garantit. La démocratie ne peut prospérer sans des journalistes capables de dire ce qui est, de poser les bonnes questions, de déranger parfois.
À l’opinion publique et à la société civile également de se mobiliser pour défendre ce bien commun qu’est la liberté d’informer. Il est encore temps de restaurer la confiance entre la presse, le pouvoir et les citoyens. Car la liberté de la presse n’est pas une faveur concédée par les gouvernants : c’est un droit fondamental, inscrit dans la Constitution, et sans lequel aucune démocratie ne peut survivre.
Boris MAHOUTO