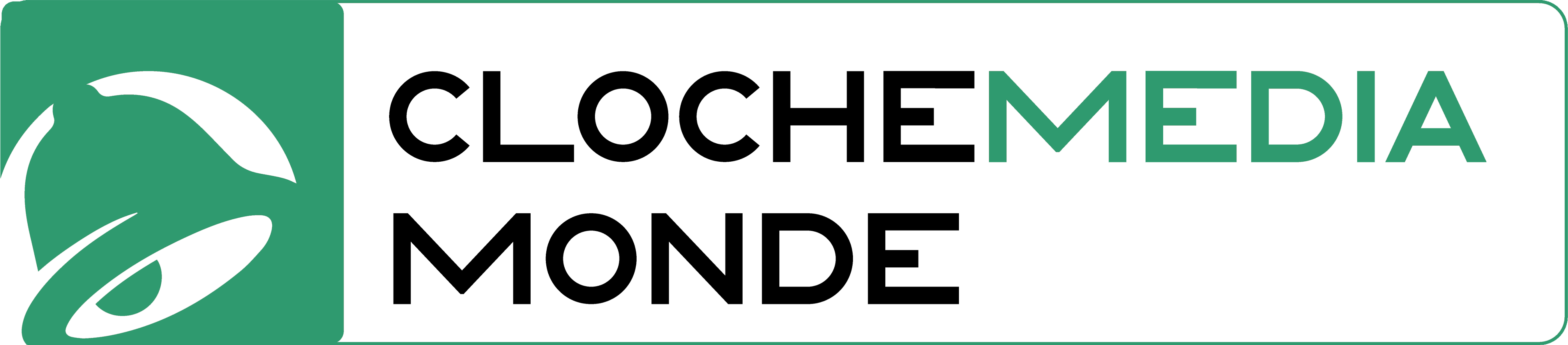Face à la menace terroriste grandissante qui plane sur les frontières septentrionales du Bénin, la question de l’efficacité des stratégies de défense et de sécurité se pose avec une acuité. Si les Forces armées béninoises (FAB) multiplient les efforts pour sécuriser les zones sensibles, la complexité du terrain et la mobilité des groupes armés exigent une approche plus intégrée, enracinée dans les réalités locales. Et si la réponse passait aussi par l’association d’acteurs traditionnels longtemps marginalisés dans la stratégie sécuritaire nationale : les chasseurs ?

Depuis plusieurs années, les départements de l’Atacora et de l’Alibori sont le théâtre d’incursions terroristes attribuées à des groupes jihadistes actifs dans le Sahel. Ces attaques ciblent des postes militaires, des infrastructures publiques et sèment la panique dans des villages frontaliers naguère paisibles. Des dizaines de civils et de soldats ont perdu la vie. Le Bénin, jusque-là épargné par la menace sahélienne, découvre brutalement la réalité d’un fléau transnational.

Les limites d’une approche exclusivement militaire
L’État a renforcé la présence des forces de défense et de sécurité, développé des opérations militaires ciblées et coopère activement avec des partenaires régionaux et internationaux. Pourtant, malgré ces efforts louables, la connaissance du terrain, les liens communautaires et la fluidité des déplacements des groupes armés rendent leur traque difficile. Les terroristes exploitent les failles géographiques, les forêts épaisses, les collines reculées, et surtout la peur ou l’ignorance des populations locales.
*Le rôle oublié des chasseurs traditionnels*
Dans ce contexte, plusieurs voix s’élèvent pour proposer une piste audacieuse : associer les chasseurs traditionnels à la lutte contre le terrorisme. Présents dans toutes les régions du Nord, ces hommes connaissent chaque recoin de la brousse, chaque sentier, chaque repaire. Leurs savoirs ancestraux, leur organisation hiérarchique, leur rôle dans la protection des communautés et leur proximité avec les habitants en font des acteurs stratégiques potentiels.

Dans certains pays comme le Burkina Faso ou le Mali, les chasseurs – souvent regroupés dans des confréries ou des milices communautaires – ont été associés aux efforts de sécurisation, avec des résultats mitigés, mais parfois encourageants. Au Bénin, leur implication reste limitée, voire inexistante. Pourtant, sur le terrain, certains chasseurs sont déjà sollicités de manière informelle pour transmettre des informations ou repérer des mouvements suspects.
*Des avantages… et des précautions*
Intégrer les chasseurs dans une stratégie de lutte contre le terrorisme pourrait renforcer la résilience communautaire, améliorer la circulation des renseignements et créer un maillage sécuritaire plus dense. Cela permettrait aussi de valoriser des savoirs endogènes souvent marginalisés au profit de modèles importés.
Mais cette option n’est pas sans risques. Elle nécessite un encadrement strict, pour éviter les dérapages, les abus ou les rivalités communautaires. Il ne s’agit pas de créer des milices incontrôlées, mais d’imaginer un cadre de collaboration bien défini avec l’État, basé sur la formation, la supervision et le respect des droits humains.
*Vers une sécurité partagée*
L’heure est venue pour le Bénin de penser une sécurité inclusive, qui mobilise toutes les ressources de la nation : forces armées, populations civiles, élus locaux, et pourquoi pas… chasseurs traditionnels. Dans une guerre où la connaissance du terrain et l’adhésion des communautés sont des clés de la victoire, ignorer ces acteurs serait une erreur stratégique.
Associer les chasseurs, c’est reconnaître que dans les terroirs du Nord, la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée sans les forces vives locales. C’est aussi poser les bases d’un nouveau contrat de confiance entre l’État et ses citoyens, entre la modernité militaire et les héritages ancestraux. Et si, en regardant vers les chasseurs, on redécouvrait une partie de la solution ?
Boris MAHOUTO