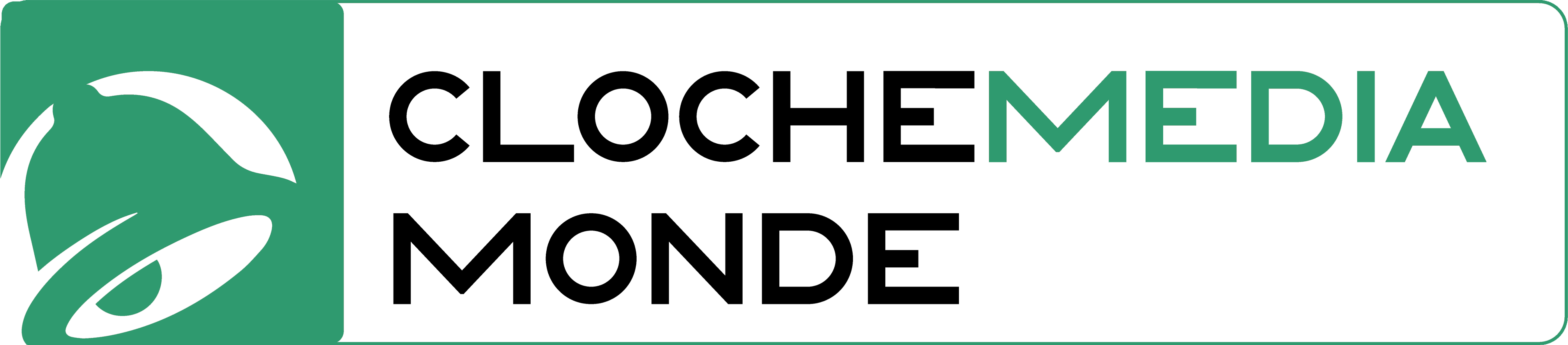Loin d’être un simple folklore politique, la communion festive autour des grands chantiers de développement a longtemps représenté un levier de mobilisation populaire et d’appropriation citoyenne, notamment pour les femmes. Depuis l’ère de la Rupture, cette dynamique semble s’être estompée, laissant un vide dans le cœur de celles qui y voyaient plus qu’un simple décor.
Il fut un temps où chaque inauguration, chaque chantier, chaque réalisation publique au Bénin était accompagnée d’une ferveur populaire rarement égalée. Sous la présidence du Dr Boni Yayi, la gouvernance se vivait aussi dans la rue, sur les places publiques, dans les villages comme dans les villes. Les femmes, piliers de la nation, y tenaient une place de choix. Leurs chants, danses, panégyriques, et invocations traditionnelles formaient une chorale symbolique en l’honneur du développement.
Loin de se réduire à du populisme ou à une stratégie électoraliste, cette communion populaire s’inscrivait dans une philosophie de gouvernance où le développement se célébrait autant qu’il se construisait. Ces moments de liesse étaient perçus comme des actes de participation symbolique, d’appropriation des politiques publiques et d’unité nationale.
À travers cette démarche, l’ancien chef d’État Boni Yayi avait instauré une forme de gouvernance populaire et inclusive, plaçant les femmes au cœur de l’action publique. L’image des “vaillantes amazones”, arborant fièrement leurs pagnes à l’effigie des projets gouvernementaux, était devenue emblématique d’un Bénin en mouvement. Les femmes chantaient le développement, elles l’accompagnaient de leur ferveur, elles en étaient les ambassadrices.
Mais voilà plus de neuf ans que cette effervescence populaire semble s’être tue. Avec l’avènement du gouvernement dit de la « Rupture », une autre vision s’est imposée, plus technocratique, plus centralisée, souvent perçue comme plus distante. Si les grands travaux et les réformes n’ont pas manqué, leur mise en œuvre s’est faite sans la chaleur humaine qui autrefois les accompagnait. “Ce n’est pas que nous ne voyons pas ce qui est fait”, confie une femme leader d’association à Cotonou. “Mais nous ne sommes plus conviées, plus consultées, plus impliquées comme avant. Il n’y a plus de communion. On sent que quelque chose manque.”
Le constat est partagé dans plusieurs localités du pays : l’absence de mobilisation populaire autour des œuvres publiques a creusé un fossé entre les citoyens et l’action gouvernementale. Et ce sont les femmes, autrefois en première ligne, qui en ressentent le plus le vide.
Certes, les temps ont changé, et les modes de gouvernance aussi. Mais faut-il pour autant abandonner ces instants de fraternité collective, où le développement était célébré comme une fête nationale ? Faut-il renoncer à ces moments de dialogue implicite entre gouvernants et gouvernés, où les femmes jouaient un rôle central, valorisées dans leur capacité à porter le rêve d’une nation prospère ?
En revisitant cette mémoire collective, certaines voix s’élèvent aujourd’hui pour rappeler que le développement ne se mesure pas uniquement en chiffres et en infrastructures, mais aussi en sentiment d’appartenance, en chaleur humaine et en mobilisation communautaire.
La politique de la Rupture a certes ses mérites. Mais pour beaucoup de femmes, la distance instaurée avec les populations a ôté au développement son âme festive. Et c’est précisément cette âme qu’elles aimeraient retrouver.
Boris MAHOUTO